11 mars 2002 Nice. Il est tellement ignorant et plein de soi que quand je lui dis qu’il est nice, il le prend comme un compliment et, d’un sourire satisfait, il me corrige : « On prononce naïs et non nis. » Pauvre con. Pauvre ignorant. Je ne réplique pas. Je le laisse barboter heureux dans sa canardière. Pauvre nice.
12 mars 2002 Œuvres.
Quand on est triste ou mélancolique, quand on a envie de se câliner à des mots
paisibles ou de se faire protéger contre l’insensibilité, quand la vacuité des
échanges nous coupe tout appétit intellectuel, on n’ouvre pas des œuvres-monde.
On n’ouvre pas Faust ou la Divine comédie, Roi Lear ou Les
frères Karamazov, quand on veut ruminer loin du monde ni quand on rêve de
mains berceuses et d’yeux apaisants : en ces moments-là, on préfère
plonger dans les œuvres d’auteurs qui lissent le monde, qui créent leur
monde : Proust, Céline, Baudelaire, Kafka… d’auteurs maîtres d’états
d’âme. Quand la vie nous enjoint de lui poser des questions dont elle ne
connaît pas la réponse, on lit, devant la cheminée, des auteurs qui enveloppent
le monde, qui nous bercent et nous aident à naviguer sur les vaguelettes de
notre âmelette ; en ces moments-là, on n’ouvre pas des ouvres-monde.
Malheureusement, il n'y a pas seulement les œuvres qui redonnent le monde ou celles qui en créent un, il y a aussi les œuvres qui ne font rien et celles qui irritent. Ces dernières, pour des gens au colon sensible comme moi, sont vraiment trop nombreuses. Hier, par exemple, j’ai lu un des derniers livres de J.-L. Nancy[1], un maître indépassable dans l’art de l’irritation. Il suffit de lire les premières quatre ou cinq pages pour comprendre qu’il n’y rien de nouveau sous les nuages : ce qui est très bien, très rassurant, mais, en même temps, c’est un peu gênant de payer 44 $ (avec cet argent au Zimbabwe on pourrait acheter 180 canettes de coca-cola et rendre heureux 180 enfants pour deux ou trois heures, le temps de ma lecture) pour faire saigner les intestins (il faut que ça saigne, si on veut dire des choses qui ont un rapport quelconque avec le monde. Il faut que ça saigne, comme saint Augustin disait). Après avoir proféré quelques banalités à propos de l’expression Urbi et orbi — qu’il n’existe plus ni la Ville ni le monde-campagne — il ne peut pas s’empêcher de faire des réflexions d’homme de soixante-dix ans en minijupe, comme quand il écrit que le tissu urbain actuel « semble de plus en plus ne pouvoir relever que de l’appellation d’agglomération, avec sa valeur de conglomérat, d’entassement, avec le sens d’une accumulation qui simplement concentre d’un côté (dans quelques quartiers, dans quelques maisons, parfois dans quelques villes protégées) le bien-être qui jadis fut urbain ou civil, tandis qu’elle amoncelle de l’autre ce qui porte le nom très simple et impitoyable de misère. » Qui jadis fut urbain ou civil ? Jadis, quand ? À l’époque de Rome impériale ? Certainement pas ! Les richesses étaient déjà pas mal concentrées. Constantinople du début de l’autre millénaire ? Paris du XVIIe siècle ? Londres ou Moscou du XIXe ? Certainement pas. Sans doute que Nancy-le-vieux continue à voir le monde comme Nancy-l’enfant qui probablement voyait les villes comme peuvent les voir les enfants qui ne sont pas en train de crever dans la misère : comme les lieux de leur vie, comme les lieux de la vie. Ce qui est une très belle manière de voir la vie, quand on a quatre ans. Les prises de positions réactiânères continuent : « […] là où est exigé un recours au "spirituel", à moins que ce soit la "révolution" (est-ce si différent ?) […] » Bien sûr que c’est « si différent », à moins que Nancy ne soit qu’un vieux curé qui nous parle du Jésus qui a porté sur terre la Parole, la Vraie révolution. Pourquoi, encore une fois, s’attaquer à ce pauvre Nancy, pas plus con que la moyenne, qui gagne sa croûte en donnant des conférences que Galilée s’empresse de publier et en désenseignant à des jeunes étudiants spongieux ? Pour plusieurs motifs :
1. Parce qu’il représente très bien l’employé de l’État qui vit parmi des LCP (lieux communs professoraux) et qui ne s’aperçoit pas que ses lieux communs sont encore plus fades que les LCC (lieu communs communs) qu’il méprise.
2. Parce que j’ai des amies qui le lisent et se font rouler dans la doctrine comme s’elles n’avaient pas encore la coquille hors du cul.
3. Parce qu’il est un des adeptes de cette majorité bavarde et réactionnaire qui voudrait se faire passer pour révolutionnaire et qui, sortie de la naïveté des utopies de jeunesse, sait que la « vraie » révolution est une autre, qu’elle est spirituelle.
4. Parce qu’il est assez malin pour dire les choses qu’il s’attend de lui-même.
5. Parce qu’il fait partie de l’armée d’intellectuels qui croit que la philosophie peut nous sauver et ne s’aperçoit pas que l’église philosophique, comme toute église, est une communauté de coupure des connexions neurales.
6. Parce qu’il va donner des conférences dans des villes de province où il rassure le besoin d’être rassurés des auditeurs ; lui qui connaît les mégapoles et eux qui n’attendent qu’on ne leur dise que ceci : que Paris est comme N. Y. qui est comme Sao Paolo qui est comme Tokyo. Un agglomérat… quelle chance que nous avons, nous, à Bordeaux ![2]
7. Parce qu’un vrai philosophe, Derrida, dit qu’il le respecte et qu’il le considère un vrai philosophe. Je ne me suis jamais demandé si Derrida (comme Sollers) faisait partie de la catégorie fort nombreuse de gens qui ont besoin de louer des pauvres crétins pour que leurs œuvres en ressortent agrandies. Aujourd’hui, je me le demande.
8. Parce que, last but not least, il me fait radoter comme un vieil âne essoufflé.
13 mars 2002 Glauque. Est-ce l’époque glauque qui met « glauque » dans la bouche de toutes mes amies ? Ou est-ce le mot « glauque » qui glauquise le monde ? Question indécidable, comme celle de la pouffe et de l’œule.
14 mars 2002 Soi et le monde. Est-ce que la connaissance du monde passe par la connaissance de soi ou vice-versa ? Une question pas tout à fait frais émoulue et un peu trop tranchée mais qui permet de séparer (j’étais en train d’écrire le grain de l’ivraie : je me prends un peu trop pour Dieu, ce matin), de séparer les outside-in des inside-out, quitte à s’apercevoir qu’il n’y a ni d’in ni d’out. Je me suis retrouvé avec cette question quand ma meilleure amie m’a dit, avec un sérieux que je ne lui connaissais pas : « Pour connaître le bien de ses amis il faut connaître soi-même. » Elle n’a pas dit cela tout de go, mais suite à une tirade d’un aristotélicien après la lettre qui nous a fait une tête comme ça :
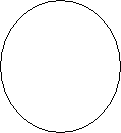
avec ses histoires de vraie amitié opposée à l’amitié fondée sur l’agréable et sur l’utile. Moi, je me suis fait ramasser parce que j’ai osé dire que la vraie amitié était un mélange d’utile et d’agréable. « Toi t’es un bon exemple de quelqu’un qui ne se connaît pas. », qu’elle m’a dit, « Tu te caches derrière les conneries que tu écris tous les jours et au lieu de te comprendre, tu joues avec les mots. Tu n’auras jamais de vrais amis, parce que quand ils seront dans la détresse tu n’auras pas des points de repère dans ton âme. T’es toujours dans le vent des mots. » Sidéré par la violence (violence dans sa bouche si douce d’habitude) inusitée de ses propos, j’ai filé à l’anglaise. Je ne me connais pas et je n’ai pas d’amis, elle se connaît et elle en a beaucoup. C’est sans doute vrai, si elle le dit. Si j’étais méchant comme elle, je lui dirais qu’il est facile de se connaître quand on a l’esprit lisse comme la peau d’un bébé. Et les bébés ont facilement d’amis, surtout quand ils sont grassouillets et ils passent leur journée à téter, chier et sourire. Je ne sais pas si c’est parce que je me sens particulièrement agressif mais j’ai l’impression que l’ignorance du monde passe par la connaissance de soi, ce qui revient à dire que la connaissance de soi est ignorance du monde et donc de soi.
15 mars 2002 Lulas chez Tasca. On a rendez-vous à 20 heures trente chez Tasca. Elles arrivent directement de la librairie où Cees Nooteboom a présenté son dernier livre. Charmant… un monsieur qui a de la classe… très intéressant, par contre certaines questions étaient tellement prétentieuses… un mec qui a beaucoup voyagé… il ne se prend pas au sérieux… soixante cinq ans ? un échange dans Le monde des livres avec Sollers… Je suis sûre que tu vas l’aimer… Je lui dis que j’ai déjà essayé et je n’ai pas pu le terminer, je ne me rappelle plus le titre… ça doit être L’histoire suivante… Le dernier est bien meilleur…Après on a parlé de drogue, d’aide, de liberté, de justice et de paresse. J’ai trop parlé et, quand je parle trop, j’ai des difficultés à m’endormir. C’est comme si l’armée des banalités qui avait livré bataille avec quelques décibels de trop revenait dans ma tête, lugubre et aveugle, pour y massacrer les restes des certitudes.
Je commence donc à relire L’histoire suivante[3]. Après les deux premières pages non seulement je sais ce que je n’aime pas, mais je sais ce que j’aurais aimé, il y a une dizaine d’années. J’aurais aimé cette façon ironique et souple de décrire le monde, cette manière de libérer la vie de sa lourdeur congénitale avec des coups de pinceaux qui ne laisse pratiquement pas de signes sur le tableau de l’écriture. Maintenant j’y vois la satisfaction, pas assez celée, de ceux qui ont compris que le monde ne peut pas être compris ; j’y trouve le contentement de ceux qui montrent (sans montrer) qu’il y a toujours une complexité autre dont il ne vaut pas la peine de parler ; je cogne contre des formules rhétoriques trop imbues d’un détachement qui aimerait passer pour « classe ».
J’aurais aimé ce début de phrase : « Chez moi, toute pensée en appelle immédiatement une autre qui la recouvre […] » Maintenant, je trouve ce « chez moi » ostensible, presque maniéré.
Quand il parle des « bizarreries des actes d’amour entre les hominiens », et il compare ses attouchements aux « tâtonnements et aux tripotages d’un aveugle », moi, myope de longue date, j’aurais été fasciné. Aujourd’hui je trouve cela artificiel et stéréotypé : le myope ne tripote pas, quand « les deux esclaves de verre rond ne se trouvent pas dans les parages », comme il écrit. Dans le toucher du myope les mains sont libres de l’esclavage des yeux et parcourent le corps, alertes et sensibles, comme seul la peau peut l’être.
La première fois j’avais arrêté la lecture à la page 34. Ça devait être parce qu’il ironisait sur les classiques d’aujourd’hui et il mettait Madonna dans le même sac que Prince et Gullit. Il y a dix ans j’aurais aimé. Aujourd’hui je suis moins peureux et je ne crains pas le virus Madonna ni tout autre virus, sinon celui de l’ironie facile.
Cette fois j’ai arrêté à la page 59, quand il parle de Pessoa : « J’envoie les veaux ruminer leur ration de saudade prédigérée dans le beuglant à fado. […] Pessoa je le garde pour moi. […] Ce n’est pas moi qui leur parlerai de métempsycoses du poète alcoolique, de son moi liquide et multiforme […]. » Il y a dix ans j’aurais continué, cet élitisme m’aurait emballé. J’aurais été sensible à ce « moi liquide », moi qui ne connaissais ni liquide ni moi. Aujourd’hui cela m’irrite. La mode Pessoa m’irrite car j’aime trop la mode pour la voir se mettre à plat ventre devant n’importe quel pitre.
Il y a dix ans… aujourd’hui. Je ne suis pas un meilleur lecteur aujourd’hui qu’hier. Il serait de trop mauvais goût, pour moi qui n’aime pas le mauvais goût des pessoaiens, penser qu’en vieillissant on s’améliore.
16 mars 2002. Connaissance. Aristote :
« On ne peut pas se connaître les uns les autres avant d’avoir consommé
ensemble bien de boisseaux de sel. » Dans mon village, quand les paysans
faisait encore la langue : « On ne peut pas se connaître les uns les
autres sans partager fumier ».
17 mars 2002. Par moments. Pour être philosophe il suffit d’avoir une intelligence médiocre, de ne pas être porté à l’action et d’avoir — par moments — un sentiment d’impuissance pour ce que l’homme est capable de ne pas faire.
Pour être écrivain il suffit d’avoir une intelligence médiocre, de ne pas être porté pour l’action et de laisser — par moments — la parole créer des trames sans que la pensée ne le sache.
Pour être homme d’action il suffit d’avoir une intelligence médiocre, d’être porté à l’action et de laisser — par moments — l’activité modifier la réalité sans qu’on ne sache comment.
Pour être poète il ne suffit pas d’avoir une intelligence médiocre, ni de ne pas être porté à l’action, ni d’avoir — par moments — un sentiment d’impuissance pour ce que l’homme est capable de ne pas faire, ni de laisser — par moments — la parole créer des trames sans que la pensée ne le sache, ni de laisser — par moments — le mouvement modifier la réalité sans qu’on sache comment.
Pour être poète il faut du sang bleu, des génitoires lourdes et la parole légère.
Mais, les hommes au sang bleu sont rares comme sont rares les hommes aux génitoires lourdes et, encore plus rares, les hommes à la parole légère.
Pour être poète il faut aimer la forme dans les paroles et les sens dans les corps.
Mais, hélas ! les hommes aiment le sens des paroles et la forme des corps.
Pour être poète il ne suffit pas d’être homme.
Je faisais ces considérations en feuilletant les dizaines de livres de poésie minable que, je ne sais pas qui, a eu le courage d’entasser sur la plus grande table de ma librairie préférée.