26 avril 2004. À propos de la culture qui aide les filles en difficulté.
Son travail pratique est un collage de textes de sites WEB. « Dans
ma culture, c’est normal de copier », me dit-elle avec une assurance que
seule une culture baignant dans le mépris peut donner.
Têtue comme un âne, elle insiste sur les qualités de son travail très mal
fait selon trois enseignants. « Dans ma culture, on ne change pas
d’avis », me dit-elle en baissant les yeux comme sa culture lui impose.
Elle pleure pour me convaincre de convaincre une collègue « Dans ma
culture. on ne pleure pas devant les autres. Si on pleure ça veut dire… »,
me dit-elle en baissant encore plus une tête que sa culture rabaisse depuis des
millénaires.
Un petit cadeau pour me remercier de l’aide. Je lui dis que je ne peux
pas accepter « Dans ma culture, si on n’accepte pas les cadeaux… »,
me dit-elle s’assombrissant et avançant une misérable boîte d’un geste royal.
Attirée vers le fond de son âme elle se recroqueville comme un petit
enfant craintif.
— Je dois me marier.
— Te marier ?
Avec le con dont tu parlais il y a un an ?
— Oui.
— L’aimes-tu ?
— Non.
— Pourquoi le maries-tu ?
— Je ne sais pas. Je l’ai aimé pendant quelques mois. Dans ma culture, on
ne se marie pas par amour.
Tout cela en une seule journée. C’est beaucoup. C’est trop pour ma
culture.
J’ai envie de sortir de toutes les cultures, surtout de celles légères, arlequinées
et aux pattes menues de caméléon.
J’ai envie de marcher lourd et noir comme mes ancêtres, les gorilles des
montagnes.
27 avril 2004 Naître dans la merde. Il
lui dit qu’une amie lui a confessé qu’elle a chié trois fois pendant
l’accouchement, mais que « les
infirmières sont si attentives… ». Il ajoute qu’il était fort étonné
d’apprendre que l’on naît dans la merde. « Toi, tu ne vis que dans ta
tête ! N’as-tu jamais entendu dire que les femmes poussent ? »
Oui, il l’avait entendu. Il avait même entendu sa mère crier à la naissance de
ses frères, mais il avait toujours pensé qu’entre les deux orifices il n’y
avait pas rap.
28 avril 2004. Ce n’est que du clonage. Faire comprendre à des adolescents que la technique et la science, jadis royaumes incontestés des mâles, sont en train de bouffer les zizis, est une tâche terrible. Terrible ? J’exagère, les mots me portent. En vérité, elle peut même être une tâche fort agréable, surtout si on peut se servir d’un dessin haut en couleur. Agréable, au début au moins.
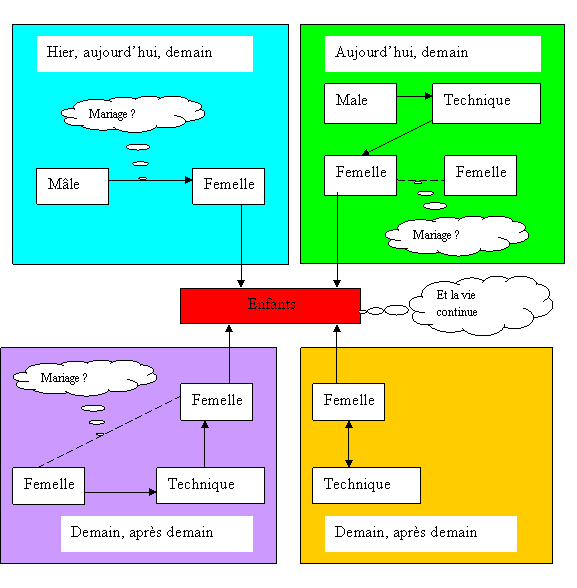
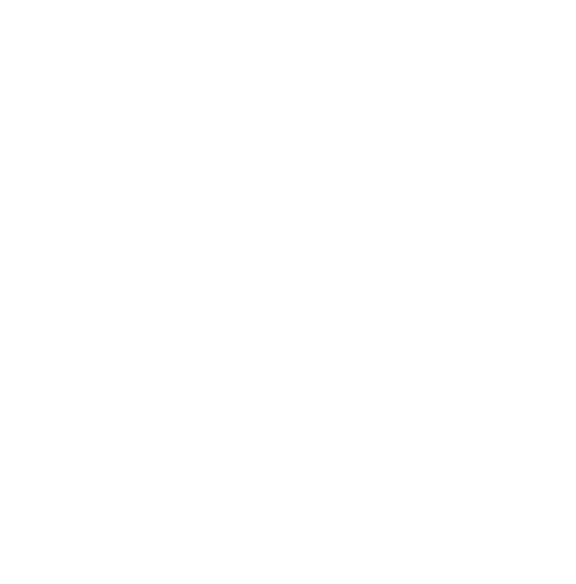
Je commence en disant qu’au centre on voit les enfants rouges qui sortent, comme tout le monde sait, des femelles. Rires. On ne s’intéressera pas à la façon de les sortir mais à comment on les fait entrer Rires et pas seulement parce que les hommes la trouve plus agréable Rires mais parce que la science aussi semble la juger plus excitante. Rires.
Dans le rectangle en haut à gauche, c’est la manière classique. Rires. Une femme, un homme et éventuellement, surtout hier, un mariage. Rires.
En haut à droite, la technique libère la femme du travail d’extraction. Ils me regardent sans trop savoir où je me dirige. J’ajoute : « comme on fait avec les vaches depuis des décennies ». Rires clairsemés. Le mariage cesse d’être un champ de bataille entre mâles et femelles. Rires. Deux femelles peuvent décider que, pour s’aimer, il faut un permis étatique. Rires. Ce qui est certain c’est que l’appendice du mâle perd une grande partie de ses fonctions. Pas de rires, et pourtant j’avais l’impression… Je continue.
En bas à gauche. La technique enlève à l’homme toutes ses tâches mââl…ines. J’attends trois secondes. Je suis sûr qu’ils vont rire. Rien. Je redémarre. On n’a même plus besoin de ses produits les plus intimes. J’attends les rires qui n’arrivent pas. Est-ce moi qui n’est pas assez spirituel ou le thème qui devient lourd ? Je ne sais pas. Déstabilisé, mais j’insiste.
En bas à droite, une seule femme. Même plus besoin… « Mais il n’y a rien de nouveau là dedans, ce n’est que le clonage », m’interrompt le jeune aux cheveux en broussaille qui m’a fixé sans sympathie pendant toute la présentation. Ce n’est que du clonage. C’est vrai. Et moi qui pensais les provoquer ! Ce n’est que du clonage.
En me voyant venir avec mes gros sabots, ils ne riaient pas pour mes paroles mais de mes paroles. C’est vrai, ce n’est que du clonage.
29 avril 2004. Dead man talking. Quand on analyse des textes littéraires on les tue. Tout le monde le sait. Ces tueries — comme celles bien plus lourdes de conséquences du Rwanda, du Soudan, du Congo, de la Palestine, de l’Irak et d’Israël, pour ne citer que les plus médiatisées — ne sont pas un simple fruit du hasard ou de l’incompétence. Elles sont une nécessité inhérente à toute analyse : c’est-à-dire à toute vivisection fondée sur une raison qui vise une certaine pureté. Un sens propre.
Mais, qu’est-ce que la pureté du sens sinon l’arrêt du temps pour empêcher que ce dernier ne ramasse pas tout ce qu’il rencontre dans sa course désordonnée ?
— Mais, étant impossible d’arrêter le temps…
— Il est vrai que l’on n’arrête pas son temps. Disons… presque vrai. Par contre on peut très bien arrêter celui des autres, celui de la société ou de la nature. Analyser veut dire prendre des photos de ce qui bouge et les étudier comme si rien ne changeait. Comme des images mortes.
— Ouais…
— Les images mortes sont si fascinantes parce qu’elles nous donnent l’illusion de comprendre. On croit comprendre quand on ne fait qu’effacer notre vie derrière les mots.
— Parle plus clairement.
— Ce sont les morts qui commentent. Quand on décrit, quand on commente, quand on parle de ce que d’autres ont réalisé pour l’inscrire dans un schéma qui facilite l’interprétation, on est des morts qui parlent. Dead man talking.
— Je ne vois pas le lien.
— Ceux qui nous laissent des « photos » ont déjà arrêté le temps et nous, en analysent, nous nous donnons l’illusion de remettre en marche le temps, tandis que nous le tuons une deuxième fois. La raison est un rasoir qui découpe les séquences du film de la vie.
— Vive l’intuition donc ?
Vive l’à peu près ? Vive les brouillons ?
— Aussi. Vive la vie. Vive tout.
30 avril 2004. Journalisme. Quand d’Alembert caractérisait la
profession de journaliste d’« épineuse », faisait-il allusion aux
journalistes qui écorchaient les puissants avec des vérités malvenues ? Ou
au fait que les journalistes qui sortaient des layons tracés par les serfs des
nobles s’écorchaient ? Ou aux deux ? Il n’est pas difficile
d’imaginer qu’un puissant écorché se prenne la liberté de faire écorcher, en
retour, l’impudent qui osa.
Aujourd’hui, dans la partie du monde où une
indéniable aisance économique va de pair avec une certaine liberté des mots, en
Occident, la profession a perdu beaucoup d’épines. En vieillissant elle a pris
des rondeur, est devenue presque soyeuse et les piquants de sa jeunesse sont
tombés dans l’oubli. Elle a plus l’air d’un pamplemousse que d’une bogue de
châtaigne. Le monde, par contre, est toujours épineux comme une châtaigne,
comme aux temps de d’Alembert.
Comme d’Alembert on pense que le journalisme
doit être épineux et on est loin de penser que, si la profession écorche moins
que l’on aimerait, c’est parce qu’il n’y a plus de puissants à piquer sur le
vif. Les journalistes de notre époque sont-ils donc plus lâches que les
polémistes du XVIIIe siècle ? Certainement pas. La lâcheté et
le courage ne subissent pas l’érosion du temps.
Le journaliste, avec les mots et les images,
transforme l’inconnu en connu.
Il doit, avant tout, baigner dans le même
« monde » que ses lecteurs — ce qui ne va pas nécessairement de soi,
car la profession favorise un style de vie éloigné du quotidien des gens
« communs ». Ensuite, il doit se balader dans un monde inconnu avec
assez de légèreté pour ne pas le troubler mais, en même temps, avec assez de
force et de conviction pour saisir ce qui le caractérise. Tâche titanesque
parce qu’il doit se libérer du poids des idées bien établies sans se
transformer en une tête vide que n’importe quoi peut remplir. Pour l’aider dans
cette tâche, des spécialisations se sont formées qui se sont tellement mises de
l’avant que l’on peut se demander
si le journaliste n’a pas été remplacé par l’éditorialiste, le chroniqueur, le
correspondant, le critique…
Les méthodes de travail se sont raffinées et de
nouvelles techniques pour mieux satisfaire les « besoins des
lecteurs » sont nées. Tout cela a rendu, souvent, le contenu une simple excuse
de la forme et un exercice pour la musculation de l’ego.
Malheureusement lorsque les méthodes et les
techniques sont trop bien institutionnalisées, trop bien huilées, le mouvement
d’allée (vers l’inconnu) et de retour (au connu) devient une simple promenade
en attente de la prochaine conférence de presse de ceux qui n’ont souvent aucun
intérêt à faire connaître l’inconnu.
Vision noire. Cadre tragique. Et noir.
Trop noir, sans doute. Sans doute que les mots
nous ont emportés, parce que, à bien y réfléchir, il y a du journalisme
critique, du journalisme qui réfléchit même sur lui-même, qui apprend de ses
erreurs. Du journalisme qui aiguise ses épines. La réflexion après la bévue de
Timisaora en est un bon exemple. Il n’y a pratiquement pas eu un journal qui
n’a pas critiqué la superficialité et la balourdise des institutions
médiatique. Timisaora a rendu un très bon service aux médias en leur permettant
de montrer comment ils peuvent réfléchir sur eux-mêmes. Certains magazines
comme le Nouvel Observateur sont même
allés jusqu’à souligner que les causes de telles bévues sont bien au-delà des
limites de leur profession : elles sont structurelles et liées à la
concurrence.
Bien. Et ensuite ?
Et ensuite rien ne change. Tout reste comme
avant, ou empire. Si l’autocritique des médias est possible et s’il est vrai,
comme ils disent, que la concurrence gâche tout, ils devraient arrêter d’écrire
dans un monde où la concurrence continue à piloter les choix, n’est-ce
pas ?
Ils ne le feront pas. Ils ne peuvent pas le
faire.
Ils ne le feront pas, entre autres, parce
qu’ils ont toujours le dernier mot. Mais ceux qui ne vivent pas des médias ont
donc le droit de penser (même s’ils n’ont pas la possibilité de l’écrire) Timisaora
comme un symptôme d’un cancer généralisé. Le signe que le spectacle (pour
parler comme Debord) règne même dans les analyses les plus barbantes.
Trop noir. Trop
pessimiste. Trop réactionnaire.
Sans doute qu’il est possible de sortir d’une
telle noirceur, de réinventer la profession comme on aurait dit autrefois. Il
suffit…
Il suffit sans doute de trouver des
journalistes sans frontières. Sans frontières disciplinaires, comme John
Berger.
Premier mai
2004. Géopolitique enfantine. Même si
les analogies entre l’empire romain et l’empire américain sont si nombreuses
que l’on en a marre d’en entendre parler, je vais en proposer une qui
vient de jaillir de mes souvenirs de l’école primaire. Comme tout petit Italien
j’étais pro Empire et comme tout enfant qui n’avait pas encore de télé, mes
connaissances de géographie étaient généreusement influencées par mes sentiments.
Pour moi le monde ancien se divisait en quatre parties : les
territoires de l’Empire dont l’extension variait en fonction de la méchanceté
des voisins ; les territoires du nord où des barbares vivaient comme des
bêtes et qui, un jour, auraient été domptés par la religion chrétienne ,
les territoires de l’Afrique profonde où il n’y avait pratiquement que des
lions, des éléphantes et des singes ; les territoires de l’est où vivaient
les méchants et cruels Parthes, insensibles à tout ce qui était beau, bon et
généreux.
Une bonne partie des Américains pensent aujourd’hui comme le petit
Italien de sept ou huit ans : les Irakiens, les Syriens, les Iraniens et
les Palestiniens ayant pris la place des Parthes. Mais ce n’est pas cette
charmante analogie que je veux souligner. L’analogie qui m’intéresse réside
plutôt du côté des puissants : du côté des empereurs et des généraux qui, dans un cas comme dans
l’autre, ne semblent pas avoir compris grand-chose. Comment pourraient-ils
comprendre que pour gagner une guerre entre des pouvoirs dont les convictions
sont profondément enracinées dans la pauvreté intellectuelle et la richesse
économique (ceux qui disent que les pays des Parthes sont pauvres ne savent pas
ce qu’ils disent), on ne fait pas de guerre armée ?
Les Parthes ne sont pas Allemands, ni Russes.
La guerre contre les Parthes ne peut se gagner qu’en arrêtant de les
combattre et en laissant le temps dévoiler que les intérêts de leurs grands et
petits chefs sont frères de ceux des nos chefs et, surtout, en ouvrant les
frontières et laissant les gens circuler et les chaîne d’ADN se mélanger.
Si j’étais historien. Si j’étais historien je dirais
qu’aujourd’hui on paye encore le prix des erreurs de l’Empire romain. Si les
Romains et les Parthes s’étaient métissés…
2 mai 2004. Géopolitique enfantine. À l’époque où je pensais que le monde de l’Antiquité était divisé en
quatre parties, je pensais que le monde moderne aussi était divisé en
quatre : L’Europe (qui en effet couvrait les territoire de l’Empire romain),
l’Afrique pleine de missionnaires et d’enfants qui mouraient de faim,
l’Amérique, l’Australie et la Suisse qui étaient un seul pays où les Italiens allaient
s’enrichir et enfin la Chine, le pays de Marco Polo. Les Parthes n’existaient
plus. Entre l’Extrême Orient et l’Occident il n’y avait rien.
Géopolitique
adolescente. Entre
l’Extrême Orient et l’Occident il y a toujours eu et il y a encore un Moyen
Orient extrême. C’est cet « extrême » non géographique qui rend
l’entrée dans le monde de la technique plus difficile pour les Parthes que pour
la Chine, le Japon et l’Inde. Le Moyen Orient extrême se bat comme une bête
blessée pour garder des conditions de vie qui font l’affaire de bien de gens, en
Extrême Orient et en Orient extrême comme en Occident. C’est une affaire d’or.
Noir. Dans tous les sens du mot.