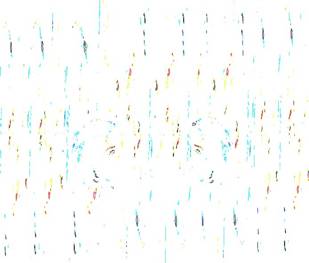28 juin 2004. Ignorant. C’est tellement agréable de lire des choses dont on est profondément ignorant ! Des mondes s’ouvrent où l’on ne s’ennuiera pas, comme dans ceux que l’on croit connaître. Ce qui semblait bâti sur la roche a les fondations dans l’argile. On respire comme quand on sort d’un bar excessivement chaud et enfumé, le mois de janvier.
Par exemple.
J’ai toujours pensé que Cézanne était le père plus ou moins picturique du Cubisme. Je n’en voyais pas d’autres : simple comme je suis, j’ai toujours pensé qu’un père suffisait. Je dois avoir appris la paternité de Cézanne dans ma jeunesse, dans une encyclopédie quelconque, ou… oui ça doit être ça… en 1967, quand je suis allé à l’exposition universelle de Picasso, à Paris, avec des étudiants de l’école des beaux arts qui n’ont pas arrêté de pontifier.
« Braque est toute autre chose » est une phrase que je n’ai jamais oubliée et qui avait été proférée avec grande suffisance, par je ne sais pas qui, devant les Demoiselles d’Avignon.
Peu importe l’origine, pour moi, Cézanne était le vrai père. Ce matin j’ai découvert un deuxième père : « Courbet est le père des nouveaux peintres [les cubistes] », et ce n’est pas n’importe qui, qui le dit, c’est Apollinaire[1]. Si c’est Apollinaire qui le dit…
Berger, contrairement à Apollinaire, croit à deux pères. La manière dont il décrit ce qui caractérise le style de l’autre père, de Courbet, « Aucun peintre avant Courbet n’a su mettre une emphase tellement sans compromis sur la densité et le poids de ce qu’il était en train de peindre » et comment il oppose « la force de gravité » en Courbet à « la perspective vers l’horizon » de Poussin sont très convainquant. Que Courbet soit lui aussi un père m’ouvre des horizons Poussiniens, s’il m’est permis de m’exprimer ainsi : je vois, très loin, poindre les dessins érotiques de Picasso influencés par la densité de l’Origine de la vie.
Si on me forçait un peu la main, je pourrais dire que l’Origine de la vie est la mère du vieux Picasso érotomane.
29 juin 2004. Braque. Qu’on ne vienne pas me dire que le hasard existe. S’il existe il s’endort souvent et laisse que la nécessité ordonne les choses à sa manière, bien ordonnée. Je lis quelques pages sur le cubisme, pense à une phrase qu’un étudiant très savant dit à propos de Braque, cherche un livre de sciences cognitives et je me retrouve entre les mains un livre minuscule : Braque le Patron de Jean Paulhan, publié en 1952. Hasard ? Ne me faites pas rire ! Mon inconscient, structuré comme une machine, m’a fait mettre les mains là où il savait que j’aurais pu enchaîner mes considérations, hélas ! désordonnées, sur les images.
Pour revenir à l’exposition parisienne, à cette époque-là j’ignorais qu’il existait un monsieur Braque qui, comme et avec Picasso, « faisait du cubisme ». Si je l’avais su et si j’avais lu le livre de Paulhan où il nous dit que son « épaule est d’un bûcheron » j’aurais certainement mieux réagi à l’affirmation de très mauvais goût devant les Demoiselles.
J’aurais encore mieux réagit si j’avais lu cette phrase de Braque, « il faut tuer peu à peu toutes les idées qu’on a eues », ou cette autre « Picasso quel peintre ! Il est capable de prendre un tableau de Bonnat, et d’y ajouter de la qualité »[2], ou cette autre, à propos d’une exposition surréaliste, « Voilà qui est excellent. Ça absorbe la presse », ou cette autre encore « Le portait c’est dangereux. Il faut faire semblant de songer à son modèle. On se presse. On répond avant même que la question soit posée. On a des idées. » ou celle-ci « Comment me serais-je trompé ? Je ne savais pas ce que je voulais. » et cette autre, que veut-elle dire ? « En peinture, le tableau, c’est l’accident ».
Ça suffit.
Ça suffit, pour les citations de Braque. Et Paulhan dans tout cela ? Comme une glace aux brisures de chocolat, le livre fond dans la tête en laissant des restes qu’on ne voudrait pas qui disparaissent. Je pourrais citer des dizaines de phrases de Paulhan, autonomes comme les brisures que la glace fait glisser au fond des idées.
Après cette lecture j’ai l’impression de connaître Braque comme aucun autre peintre, je vois ses tableaux chercher leur fin à coup de d’encadrements, de reliefs, d’abandons…
« Le peintre avec eux [Braque et Picasso] avait une fois pour toutes fait sa découverte. Il se taisait désormais, tout abandonné au parti pris des choses, et l’on pouvait entendre jusqu’au murmure le plus timide du citron et du homard. »
Et pour finir : « [La peinture moderne] a certes raison de peindre des vaches vertes ou des cubes. Mais peut-être s’en contente-t-elle un peu plus qu’il ne faudrait. Avec trop d’insistance. Avec trop, dirait-on, d’indiscrétion. […] Mais Braque sait […] qu’à divulguer le mystère, on lui retire sa vertu. Il connaît un secret, ce serait peu. Il a le sens su secret. […] Bref, l’homme qui a inventé, après Cézanne, la peinture moderne, est aussi celui qui sait la protéger de l’indiscrétion. »
30 juin 2004. Généralisation.
Que de fois me suis-je fait engueuler parce que je disais que les femmes sont plus
intelligentes que les hommes… que les Marocains sont plus hypocrites que les Algériens
… que les jeunes sont…
Avec raison. Toute généralisation est une camisole de force qui fait
appel à la violence des lâches, qui ouvre la porte au simplisme, porteur de racisme
— la généralisation politique par excellence. Mais, une fois qu’on a dit cela,
on n’a rien dit, car, derrière, il y a un énorme problème. Tragique. Un vrai
problème, vrai dans le sens qu’il n’a pas de solution sinon du genre alexandrin[3] : dès que les mots prennent
position dans notre tête, elle, la tête, généralise. Il ne faudrait sans doute
pas que je généralise à propos des généralisations, mais, ai-je le choix ?
Il y a des généralisations de toutes sortes, plus ou moins dangereuses,
plus ou moins bêtes, mais, toutes (ce mot est terrible !)… presque toutes… un certain
nombre d’entre elles ne sont que l’expression de l’état d’âme et de la vision
du monde de celui qui généralise. Et comment pourrait-il en être autrement ?
Où trouve-t-on les pires « généralisateurs » ? Parmi les
philosophes, bien sûr, puisque leur métier est de généraliser. C’est pour cela
qu’il est si facile et normal d’en trouver de mauvais.
Je ne sais pas si Jean Baudrillard est un mauvais philosophe, mais ce que
je sais c’est que, quand je lis un phrase comme celle-ci, les couilles m’en
tombent : « Si les hommes
créent ou fantasment des machines intelligentes, c’est parce qu’ils désespèrent
secrètement de leur intelligence, ou qu’il succombent sous les poids d’une
intelligence monstrueuse et inutile : ils l’exorcisent alors dans les machines pour pouvoir en jouir et en rire ».
Les hommes ? Voilà une généralisation que je ne supporte pas, qui me
fait presque regretter les sociologues qui auraient ajouté un qualificatif à
« homme » pour rendre le terme moins générique (homme occidental, homme
moderne, homme travailleur…). Sur les quelques milliards d’hommes, combien
« créent ou fantasment des machines intelligentes » ? Et, parmi
ceux-ci, combien « désespèrent » ou « succombent » ?
Des ingénieurs, des informaticiens, des cognitivistes travaillent dans
des centres de recherche pour construire des machines qui font ce que les
machines précédentes ne pouvaient pas faire. Ils sont financés par l’industrie
et les gouvernements et ils sont plus ou moins désespérés comme les bergers
mongoles, les jeunes de Montpellier, les maçons d’Alger…
Et penser que, quelque part, j’ai lu qu’il a déjà été marxiste et qu’il a
fréquenté Nietzsche. Aïe, aïe… je désespère de son intelligence.
Premier juillet
2004. Privé. Une photo de Bremer, le consul impérial, entre
deux gardes du corps privées, armées jusqu’aux lunettes, fumées. Le
journaliste, américain, s’étonne ou feint de s’étonner. Il se demande pourquoi
Bremer ne se fait pas protéger par des militaires « normaux ». Je
vais lui répondre : parce que les empereurs ont toujours fait confiance
aux seuls prétoriens, et les prétoriens font bande à part. Ils sont au-delà de
l’État. Ils sont au service de la personne. Ils sont privés.
2 juillet 2004. C’est
du cinéma. Rien de plus normal, vu qu’il s’agit de Martin Scorzese qui
parle de Marlon Brando. Martin Scorzese a 12 ans, quand il voit pour la
première fois un film avec Marlon Brando (On
the Waterfront) : « Cette
expérience a un rôle déterminant dans ma formation. Je découvris un type de
communication entre l’acteur et son public que je croyais appartenir au seul
néoréalisme italien. » Je ne crois pas que Scorzese ment, je crois
qu’il fait du cinéma : qu’il se raconte, qu’il nous raconte une histoire.
C’est son métier. Croyez-vous qu’un enfant de douze ans puisse faire des
considérations sur le jeu des acteurs et le néoréalisme ? Moi, non. Et
n’invoquez pas le fait que Mozart composait à 6 ans et que Picasso à 10 était
déjà un maître ! Pas rap. Ici, dans le cas de Scorzese, il s’agit d’un
enfant qui conceptualise et non d’un enfant qui agit et fait, poussé par une
force qu’est lui-même. Que cette expérience ait eu un « rôle
déterminant », pas de doutes ; je pourrais aussi
lui concéder qu’il découvris un type de communication, même s’il est probable
qu’il ne le savait pas ; là où je ne peux pas le suivre, sans doute parce
que je ne sais pas faire du cinéma, c’est quand il ajoute « que je croyais
appartenir au seul néoréalisme italien. ».
De quel droit le mettre en doute ? Du droit des hommes d’un certain
âge qui réécrivent les anecdotes de leur enfance pour expliquer ou justifier les
comportements ou les sentiments qui semblent nécessiter une origine solide. Ou
consciente.
C’est du journalisme. J’ai écouté quatre ou cinq émissions radio où on parlait de Marlon Brando. Les mêmes banalités, en provenance certainement de la même agence de presse ou du même site WEB. Pas un seul journaliste n’a fait la moindre référence à sa « lutte » contre Gillo Pontecorvo. Pourquoi ? Parce qu’ils ne la connaissent pas ? Impossible. Et alors pourquoi ? Parce que ils ne la comprennent pas.
3 juillet 2004. Transformation.
Dans le cadre du vingtième colloque-exposition 3P (Poésie, Peinture, Photo)
et le parler des choses, organisé par l’université de Bordeaux à
Saint-Jean-Pied-de-Porc, notre copain Adolphe Demonc, a présenté 99 tableaux qui
synthétisent son travail de recherche et création des dernières 15 années. La
critique a totalement ignoré les œuvres demonquiennes. Malgré nos efforts nous
n’avons repéré qu’une note, squelettique et méchante, dans l’édition de Bayonne
du Sud-Ouest « Point négatif de l’exposition, les 99
tableaux d’un dénommé Adolphe Demonc dont seuls les encadrements ont un certain
intérêt. On espère que l’année prochaine les organisateurs emploieront de
manière plus avisée l’argent public. »
Fidèles au principe du
Trempet qui clame que : « chaque membre défend les actions, les idées et les prises de position
des autres membres même quand il n’est pas d’accord »,
je vais essayer de montrer que les œuvre de Demonc ont plus d’intérêt que ne le
pensent les journalistes et les universitaires français.
« La
poésie de la photo, née de l’attachement maniaque au détail, transforme les
manières de voir des tableaux en manière de sentir l’incarnation de l’image
dans la couleur », c’est ce que Demonc a fait écrire au dessus
de la porte de la salle de son exposition. Ironique ? Pédant ? Prétentieux ? Cryptique ? Un peu de tout. Comme toujours, dans
ses prises de position, il est difficile de comprendre où s’arrête le jeu et où
le jeu commence.
Il m’est impossible, à
cause de la lourdeur des images, en terme de bit, d’insérer une copie de toutes
les œuvres. D’une manière arbitraire j’en ai choisi onze, qui me semblent donner
un cadre assez complet de la démarche de Demonc.
Avant de vous montrer
les œuvres, précédées d’un court commentaire, je dois ajouter que, comme dans
l’exposition 3P, l’ordre dans lequel on regarde les tableaux est fondamental
pour transformer, comme essaie de faire Demonc, ce qui est souvent un simple
procédé esthétisant en un discours sur l’art en tant que travail de
surdétermination de la réalité. En tant que travail du rêve. Les œuvres sont
présentées en ordre temporel inverse par rapport à leur exécution dans le but
de démasquer certains procédés mécaniques de l’art abstrait et non pas dans le
but, enfantin, de mettre à nu le procédé artistique. En cela je suis un adepte
fidèle de Demonc qui croit que l’art nu est une « impossibilité impossible »
et qu’un masque ne tombe que quand son autre a pris sa place.
* * *
|
Mallarmé 87 |
Mallarmé 74 |
Mallarmé87. Œuvre abstraite, ou non figurative,
comme il serait plus correct de dire, caractérisée par l’opposition de couleurs
chaudes et froides qui donne une impression de tension irrésolue. Presque de
non fini. Si on a absolument besoin d’un référent, on peut imaginer la campagne
automnale vue à travers les grilles d’une villa, ou on peut penser à des motifs
pour une tapisserie. Un torchon de cuisine, aussi.
Mallarmé74. Le côté torchon n’est clairement
plus là et une certaine prétention picturale fait surface. Les couleurs chaudes
et froides n’ont plus besoin d’une trame sous-jacente pour que l’on sente une
unité dialectique : elle se dilatent l’une vers l’autre ou l’une sur
l’autre. Pour ceux qui sont à la recherche de référents, d’utilité donc !
voilà un bon motif pour des jupes longues pour des bourgeoises qui fréquentent
les expositions.
Mallarmé 61 |
Mallarmé 52 |
Mallarmé61. La troisième dimension acquiert une
présence d’une corporalité presque excessive. Un hommage au cubisme et en même
temps un hommage à la ville. Ce n’est pas un hasard si la partie la plus aplatie
est le centre ville. Comme toujours dans Demonc, l’art est inséparable du
politique. Je vais donc, au risque de me faire engueuler pour excès de rectitude
politique, parler de « centre ville sans relief comme un billet de
banque ».
Mallarmé52. Un retour vers l’absence de relief
des premiers Mallarmé, mais avec une
rupture de la répétitivité verticale et l’apparition de deux
« taches » au centre qui rompent la symétrie. Une fois que les deux
« taches » sont là, bien en vue, et que l’on revient aux tableaux qui
précèdent, force est de noter qu’elles étaient déjà présentes bien qu’« invisibles ».
Pourquoi n’apparaissent-elles que maintenant ? Sans doute à cause du
point, du trou, noir, dans la tache de gauche.
|
Mallarmé 43 |
Mallarmé 37 |
Mallarmé48. et Mallarmé37. Le blanc et le noir. La pureté et la profondeur. Le
dessin qui tâche de sortir du blanc de la toile, en Mallarmé48. Une couche sale, un voile qui couvre le dessin qui a
l’air de vivre sur la toile, en Mallarmé37.
Jeu d’oppositions que notre choix met en évidence de manière presque
ostentatoire mais qui a besoin de douze œuvres pour se réaliser dans
l’exposition. Douze œuvres, qui correspondent à un travail d’à peu près un an.
Deux tableaux séparés par la lumière d’un an.
|
Mallarmé 35 |
Mallarmé 22 |
Mallarmé35. Dans la fluidité aquatique de ce
tableau, les deux taches deviennent deux visages de femmes qui ne se regardent
pas. Les motifs verticaux commencent à se transformer, de simples couleurs
opposées, en tremblement de quelque chose de figuratif. Quelque chose de
déformé, en dessous duquel une image semble poser un appel.
Mallarmé22. Les deux visages ont créé leurs
images négatives. De mort ? Les couleurs plus saturées nous montrent du
bois. Bois qui, si on se concentre sur les visages, devient un rideau
transparent. L’un des thèmes préférés de Demonc : la fluidification de
l’image opérée par le déplacement de l’œil du spectateur-acteur. Du bois opaque
au rideau transparent. Du rideau transparent au bois opaque…

Mallarmé7. Ici on est, sans aucun doute, dans
un figuratif hemslevien où les éléments verticaux sont des déformations des
visages des filles. Des filles qui sont une seule fille dupliquée. Les yeux de
la fille sont trop présents. Je dirais presque dérangeants. Réels comme l’est
toujours l’œil dès qu’il simule un regard. Dès qu’il cherche une entente.

Mallarmé2: Voici l’original à partir duquel les
transformations ont été opérées. No
comment, sinon pour dire que l’opposition entre le bleu des cheveux et le
marron de la peau de la fille s’est transformée dans les premiers tableaux
(dans les derniers en ordre d’exécution) dans les barres derrière lesquelles le
porteur du membre est prisonnier dans l’original. Original qui n’en est pas un.
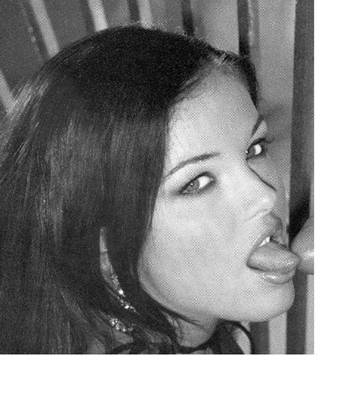
Mallarmé1 :
Voici le vrai original qui, à vrai dire, n’est pas le vrai original non plus : pour ne pas froisser
les ânes sensibles j’ai coupé une partie de la photo et je l’ai transformée en
noir et blanc, ce qui est censé la rendre plus artistique. Quoi dire de cette
photo sinon qu’il s’agit d’une photo porno classique à la Penthouse ? Que l’expression de la fille est complètement
artificielle ? que tout relève du stéréotype ? Que toute densité de
sens a été annulée par une sorte d’académisme de la porno ?
Et pourtant, il y a quelque chose d’autre à dire.
Que la photo, par rapport à la
« peinture » de Mallarmé2,
est plus présente. Plus dérangeante. Plus proche de la vie du désir, du désir qui
ne s’emprisonne pas dans des catégories esthétiques, morales, artistiques… Les yeux, même dans leur fausseté, sont vrais.
Dans la photo d’une personne vivante les yeux
ne sont jamais morts.
En ne nous donnant aucune voie d’accès à ce qui
se passe à l’intérieur du personnage, ils pèsent encore plus. Ils écrasent notre
conscience fausse.
Pour en finir : quel est le message de Demonc ?
Il serait trop stupide d’essayer de dire, avec encore plus de mots, ce
que les quelques images commentées ont essayé de montrer. Mais, pour ceux qui
sont toujours à l’affût d’explications, en voilà une, sous forme de
questions :
Et qu’en est-il de l’original de l’original : c’est-à-dire des
images dans la tête de Demonc et dans la vôtre ? Et de l’original de
l’original de l’original : c’est-à-dire de l’image en chair et lumière qui
a impressionné la pellicule Kodak et les neurones de Demonc ?
En guise de queue.
Pour ceux qui se demandent pourquoi les œuvres portent comme titre Mallarmé, voici mon échange avec Demonc
qui montre très clairement le style de cet homme inclassable.
— Pourquoi les as-tu titrées Mallarmé ?
— As-tu lu l’Après
midi d’un faune ?
— Oui. Le lien me semble un peu simplet.
— Ce n’est pas ce que tu penses. Tu ne vas pas
chercher bien loin. Combien de version du poème connais-tu ?
— Une.
— Découvre l’autre et tu comprendras. Et,
n’espère pas que je t’aide plus que ça.
4 juillet 2004. Angoisse.
Je ne sais pas ce que je payerais pour connaître l’angoisse. J’ai lu des
dizaines de livres d’écrivains angoissés, fréquenté de nombreux individus qui
se disent plus ou moins angoissés, et moi ? Pourquoi n’ai-je pas droit à
ma part d’angoisse. T’es con ! L’angoisse est une
souffrance. Il faut vraiment être masochistes pour vouloir souffrir. Toute
considération sur le fait qu’une souffrance chasse l’autre mise à part, l’angoisse
est une souffrance spéciale. Noble. Certains disent même qu’elle est ce qui
fait que l’humain est humain. Suis-je un simple animal ? Je dois être un
animal, pas nécessairement simple, mais un animal. Je vis dans la parole et
dans les concepts comme le tigre dans la jungle. Je n’ai pas de moi profond qui
puisse sentir l’angoissante présence du manque. Même le manque du manque,
contrairement à ce que dit le vieux Jacques, ne me donne rien de spécial.