12 juillet 2004.
Variation autour de deux ou trois thèmes.
T. est une artiste.
T. a quarante-cinq ans, quatre enfants et un mari.
T. n’a pas un sou.
T. est une emmerdeuse comme peu de gens peuvent l’être. Elle est aussi
prétentieuse et méchante.
T. dit que sa mère ne l’a pas aimée. Que personne ne l’aime pour ce
qu’elle est.
T. se pense intelligente, mais elle ne l’est pas. Si elle l’était, elle
saurait que, à moins d’être très masochiste, il est impossible de l’aimer pour ce qu’elle est. Son mari, un simple
médecin, est très masochiste, mais lui aussi est au bout du rouleau, comme il
dit.
T. déteste sa mère.
P. en a marre de faire des piges.
P. a cinquante ans, un enfant et un mari.
P. n’a pas un sou.
P. est très souvent déprimée. Elle est aussi angoissée et pas sûre
d’elle.
P. dit que sa mère ne l’a pas aimée. Que personne ne l’aime pour ce
qu’elle est.
P., contrairement à ce qu’elle pense, est très aimée : il faut être plus
que « pas sûre de soi » pour ne pas s’apercevoir que l’on est aimé,
par plein de gens. Son mari, un simple mécanicien, lui dit qu’elle doit…
« Je sais ce que je dois… j’en ai marre du devoir ».
P. en a marre de sa mère.
S. est une « femme à la maison ».
S. a quarante ans et un fils.
S. n’a pas un sou.
S. est triste. Très très triste. Elle est aussi bavarde, très bavarde.
Certaines mauvaises langues disaient qu’elle souffre de psittacisme.
S. dit que sa mère ne l’a pas aimée. La mère de S. ne pense pas ça. Au
contraire. Contrairement à ce que S. dit, sa mère n’est pas si bête que ça. Ses maris durent au
maximum une semaine mais lui disent qu’elle est jolie et sensible.
S. les croit.
S. a honte de sa mère.
R. est une écrivaine.
R a trente-cinq ans, un enfant et une femme.
R. n’a pas un sou.
R. est agressive. En profondeur, très en profondeur, tellement en
profondeur que les gens ne le voient pas.
R. dit que sa mère l’a beaucoup aimée. Sa femme, une simple employée,
sait qu’elle est agressive : on n’emploie pas un godemiché comme ça si,
enfouie sous des dehors paisibles, on n’a pas une énorme charge d’agressivité,
qu’elle me dit.
R. adore sa mère.
13 juillet 2004.
Famille. Notre génération, par ailleurs si volage,
avec un acharnement dont on l’aurait crue incapable, a lutté contre la famille.
Contre ce lieu de petitesse, d’hypocrisie, de fermeture, de vertus vicieuses.
Contre les nids de vipères. Elle a lutté et elle a gagné. Au moins quelques
batailles.
Mais alors, pourquoi les journalistes, dans tous les pays de l’empire du
marché, un mois oui et l’autre aussi, nous pissent un article qui parle de la
« vieillesse » de nos jeunes, de leur acceptation des parents (il y
en a même qui préfèrent les parents aux amis !), de leur train-train
quotidien à l’ombre de papa et maman ? Parce qu’ils doivent écrire quelque
chose pour mériter leur salaire ? L’explication est un peu courte, même
s’il est vrai que les jeunes sont un puits sans fond pour les claviéristes et
les trompettistes des médias. Je crois qu’il y a quelque chose de plus. De plus
malade. On est incapable d’admettre que des familles heureuses existent.
Pire ! Incapable de croire que la génération qui a détruit un certain type
de famille ait été capable d’en créer une autre beaucoup plus saine.
Pourquoi ? Parce que écrire de la joie, quand ce n’est pas sous
l’égide de la fadeur, est une tâche inhumaine. Seuls des nihilistes et des
« pessimistes » comme Leopardi peuvent le faire.
Jouis.
Et si cet amour de l’écriture triste et défaitiste aidait à comprendre la
réticence de beaucoup d’homosexuel envers le mariage « gai » ?
14 juillet 2004.
La mère de Roland Barthes. J’ai toujours
eu beaucoup de préjugés sur Roland Barthes. Allez savoir pourquoi ! Je
détestais le très peu de choses que j’avais lues de lui et qui se résumaient,
je crois, à Fragments d’un discours
amoureux et un article ou deux (dans Tel
Quel ?). Je le trouvais en même temps banal et complexe. Complaisant,
surtout. La chambre claire[1]
fut donc pour moi une sacrée surprise. Une surprise d’autant plus forte que le
début me confirmait dans mon opinion première. Quand je lus « […] car c’est l’image qui est lourde, immobile,
entêtée […], et c’est moi qui suis
léger, divisé, dispersé » ou « Car la photographie, c’est l’avènement de moi-même comme autre :
une dissociation retorse de la conscience d’identité », je fus sur le
point de lâcher. Je trouvais qu’il cabotait avec trop d’aisance entre banalité
et intellectualisme. Et puis, et puis tout d’un coup il se libère. Il s’envole.
Je m’envole.
Il jette à l’eau tout un fatras de concepts
usés et, attiré par la lumière de sa mère, s’éloigne de la basse côte, acquiert
vitesse et sensibilité. Il plonge, sans peur. Sans souci. Nu comme quand il
sortit du seul lieu où, comme il le dit en citant Freud, on est sûr d’avoir
été. Avec, comme seul souci, de retrouver sa mère. Cette mère « discrète »
qui « savait toujours substituer à
une valeur morale, une valeur supérieure, une valeur civile ».
Et pourtant, on pourrait croire qu’il ne se
libère pas d’une érudition facile. Deux termes latins, studium et punctum, ne
ponctuent-ils pas son enquête ? le terme sanskrit tat ne vient-il pas, dès le début, nous clouer à notre ignorance ?
operator et spectator ne sentent-ils pas le besoin de se montrer à un rythme
fort soutenu ? et sténopé pour
petit trou ? Et bien, non. Si, comme lui, on plonge, on s’aperçoit qu’il
n’avait pas le choix, dans une entreprise qu’il veut si personnelle, que de
s’appuyer sur quelques termes qui solidifient les impressions. Des termes que
l’histoire a épurés. Si cela semble trop ad
hoc, je peux toujours dire qu’on lui pardonne ces savanteries parce que le texte est tout autre que le texte d’un
érudit : c’est le texte de l’enfant qui
ne croit pas que sa mère puisse partir, pour toujours.
Au gré des rapports entre studium (« l’application à une chose, le goût pour quelqu’un, une sorte d’investissement
général, empressé, certes, mais sans acuité particulière ») et punctum (« […] piqûre, petit trou, petite tache, petite coupure — et aussi coup de
dés. Le punctum d’une photo, c’est ce
hasard qui, en elle, me pointe (mais aussi me meurtrit, me poigne) »),
celui qui regarde lie, plus ou moins sobrement, ce que la photo a
« arrêté » avec les affects qui l’animent.
Le studium,
analyse « scientifique » qui cherche la signification que les images
cachent, est ce qui est partageable entre gens de la même culture. Le punctum est le détail qui frappe une
sensibilité particulière, c’est la poésie de l’unicité. C’est ce qui fait que
l’amour qu’on porte à quelque chose est plus profond qu’on ne le pense. C’est
ce que le passé, concassé dans notre corps, reçoit, comme un rayon de lumière.
De liberté.
Sa mère vient de mourir. Il cherche dans les
photos « la vérité du visage »
qu’il avait aimé. « Ces photos que
j’avais d’elle, je ne pouvais même pas dire que je les aimais. [...] Je les
égrenais mais aucune ne me paraissait vraiment "bonne" ». Il
est dans le studium, dans le travail
de recherche. Il ne trouve pas. « C’est presque elle ! ». Presque. Pas de piqûres. Rien qu’un mal
sourd et généralisé. La poésie ne s’envole pas du papier. Les photos sont
plates. Quand… « Je la découvris.
[…] La photographie […] montrait à peine deux enfants débout […]
ma mère avait cinq ans (1898), son frère
en avait sept. […] J’observai la
petite fille et je retrouvai enfin ma mère. »
Il a trouvé ce que personne d’autre ne pourra
jamais voir, ce qui lui permet de rétablir le
lien que sa naissance avait brisé.
La chambre est claire.
Une grande et belle excuse pour parler de sa
mère. Sans doute.
* * *
Je n’ai aucun droit de le penser, mais
quelque chose de plus fort que moi me dit que les choses ne se sont pas passées
comme il l’écrit : qu’il est arrivé à la photo de sa mère après une longue
traversée de la photo. Je pense que, depuis longtemps — depuis que dans
« ces après-midi d’été où [il prenait] le tramway de Bayonne pour aller
[se] baigner » à Biarritz — il avait la photo de sa mère entre les idées
et à cause d’elle et seulement à cause d’elle, après la mort de sa mère, il a
commencé a écrire sur la photo.
P. S.
Quand il parle de la photo pornographique,
Barthes a une vue très courte, mais on lui pardonne. On ne parle pas de ces
choses-là devant sa mère.
15 juillet 2004. De bonne heure. La nuit vient de se coucher. Un
groupe de jeunes traverse en hurlant la rue Saint-Laurent. Trois adolescents,
assis sur les marches d’une librairie, complotent pour le bonheur. Un gars et
une fille se soutiennent tremblotant à l’angle de Prince Arthur. Seul, je
marche vers mon travail.
Il y a quelques décennies, avec des copains,
je traversais la place du village en criant pendant que la mère de Gianni
marchait vers la laiterie. Assis sur les marches du bar, on discutait de la
mort du Che quand Luigi, que l’Amérique avait fait rêver, en marche vers
l’alpage, nous criait : « Amusez-vous, l’âge de l’insouciance est
courte comme une bitte ».
La nuit vient de se coucher et je marche vers
l’université, comme mon grand-père marchait vers l’étable.
Quand suis-je passé de ce côté-ci ? Je
ne sais pas. Faudrait pas que je fasse comme si j’étais encore de ce côté-là.
16 juillet 2004 Photo égyptienne. Je viens de terminer Une autre façon de
raconter[2]
et je ne peux pas regarder cette photo

sans penser au dessin de Berger :
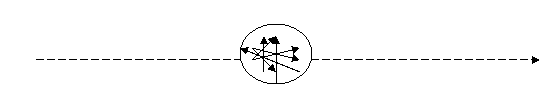
Où la flèche pointillée représente les « les événements qui se meuvent vers et à
travers le sens […] la photographie
arrête le mouvement et coupe à travers les apparences de l’événement
photographié ». Le cercle est une « section transversale de l’événement […]. Son diamètre dépend de la quantité d’information que l’on peut
retrouver dans les apparences instantanées de l’événement ». Les
flèches dans le cercle sont l’énergie des « autres événements […] qui
élargit le cercle au-delà de la dimension de l’information instantanée ».
La photo est tirée du magazine Middle East Report du printemps 2004. Si
je n’avais pas cité le titre du magazine, vous auriez pu penser que les
personnes photographiées étaient des Marocains, des Tunisiens, des Égyptiens…
des arabes, quoi. Sans doute que quelqu’un qui connaît les pays arabes mieux
que moi aurait pu être plus précis. Il aurait pu dire, par exemple, que le
meuble au coin droit ne pourrait jamais être dans un bureau marocain ou que le
foulard de la femme… Personne, par contre, ne pourrait douter qu’il s’agit d’un
bureau : le bureau transcende les cultures : tout État moderne comme
toute entreprise a des bureaux : est une bureaucratie.
Puisque cette photo apparaît dans un magazine,
on est porté à penser qu’elle est là pour nous informer. Mais, dans ce cas-ci,
l’information la plus évidente et sans doute la plus importante n’a pas été
photographiée. Elle a été ajoutée. C’est un rectangle noir qui cache le visage
d’un homme. On ne peut donc que se demander : « pourquoi cette
censure ? Pourquoi lui et pas les autres ? Qu’a-t-il à cacher pour
qu’on le cache ? » Le fait qu’il soit le seul sans visage (il
vaudrait mieux dire sans yeux) nous fait comprendre qu’il est spécial. On veut
clairement garder son anonymat. On, qui ? Les journalistes.
Si je vous donne le titre du dossier
« Suppression de la sexualité et l’État », vous commencez à voir un
peu plus clair. La photo aurait pu être prise dans un bureau de la police. Et,
si j’ajoute que le titre de l’article est « Protection virtuelle de la
moralité en Égypte », vous n’avez plus de doute que celui qui est caché
est protégé par le magazine contre les protecteurs de la moralité égyptienne.
Où sommes-nous arrivés après toutes ces
tentatives de désambiguïser la photo ? Nous sommes dans un bureau de la police
égyptienne avec un homme debout, au visage caché par le rectangle de la censure[3].
Et la légende ? Cette photo a-t-elle une
légende ? Oui : Homme arrêté lors du
raid du bateau Queen et qui écoute sa
sentence lue devant une cour du Caire. Il est fort probable que le Queen ne vous dise rien à moins que vous
ne suiviez les événements liés à la répression des gays dans le monde.
Le 11 mai 2003 cinquante-deux hommes furent
arrêtés pour comportement immoral sur le bateau-discothèque Queen amarré autour d’une bitte sur le
Nil, au Caire. Depuis longtemps les autorités savaient que la communauté gay
égyptienne se donnait rendez-vous sur le Queen
mais il n’y avait jamais eu d’intervention. Middle
East Report croit que la descente de la police fut une manière de détourner
l’attention des énormes problèmes économiques.
Maintenant, vous en savez un peu plus sur la
photo, sur le magazine, sur l’Égypte et sur la condition des gays. Vous savez
aussi que la personne sans visage est gay et que le magazine ne veut pas qu’on
la reconnaisse. Vous savez aussi qu’on est au Caire. Si vous saviez déjà que
les gouvernements des pays arabes sont homophobes, vous en avez une autre
confirmation.
Mais retournons à la photo et à sa légende.
« Toute photographie est un statut de fait », écrit Berger, oui, surtout une photo qu’un article de critique sociale emploie pour appuyer son discours. Le fait est là : un homme débout dans un bureau de police qui « écoute sa sentence lue… ». Non. Un autre fait est là. La légende, par souci de rectitude politique, décrit ce qui s’est passé après cette prise de vue. Contrairement à ce qu’elle indique, l’homme au visage caché n’écoute pas. Il est même le seul, avec l’homme placé à la gauche de la femme, qui n’écoute pas. Même si on ne voit pas sa bouche, on comprend qu’il parle et on peut même imaginer ce qu’il est en train de dire : « mes mains sont propres… » ou « je vous assure que… ». Il parle et il ment. Comment sais-je qu’il parle ? Le contexte et le regard de la personne au fond de la table, à sa gauche, dont le regard ironique dit : « ne raconte pas des sornettes, j’en connais bien d’autres comme toi ». Comment sais-je qu’il ment ? Il ment parce qu’il doit mentir s’il veut être fidèle à son corps, comme le disent ses mains.
Continuons le studium, comme dirait Barthes. Pas de punctum ici. Pour moi, au moins.
Trois personnes regardent l’homme sans regard
de trois manières très différentes : à sa gauche, le regard ironique dont
j’ai parlé ; à côté, une femme avec un air désolé (pourquoi as-tu fait
cela, mon fils) et le dernier de la rangée, le premier pour celui qui observe,
au regard sérieux et impersonnel du bureaucrate qui croit à ce qu’il fait. Les
deux autres personnages ne regardent pas. Ils sont trop conscients de la
présence du photographe. Le responsable du bureau (il est clairement le
responsable et s’il ne l’est pas il y aspire), avec la main artificiellement
armée d’un crayon, veut que le photographe immortalise son profil pour que les
générations futures sachent qu’il était là. Le dernier personnage regarde le
photographe d’un air assez méchant (que veux-tu si le gouvernement change, je
ne veux pas que cette photo me montre parmi les persécuteurs, je veux avoir le
droit de changer).
Pourquoi tout ce studium ? parce que je n’ai pas pu faire autrement après avoir
lu Berger et Barthes. Et le punctum ?
Aucun. Aucun pour moi.
Et le cercle dont parle Berger ? L’ai-je
trop élargi par trop de studium ?
17 juillet 2004 Toucher. « La dernière fois qu’il m’a touchée, c’était en 1939. » Cette phrase
est très précise, et surtout très claire : une personne de sexe féminin
dit que quelqu’un de sexe masculin ne l’a plus touchée depuis 1939. Claire
comme peut l’être une phrase isolée. Comme peut l’être un poème. Qu’est-ce
qu’un poème sinon une longue phrase ouverte à toutes les interprétations ?
Ce qui ressort de cette phrase, ce dont la
présence est presque obscène, pour les Occidentaux, c’est ce 1939. C’est un
problème d’yeux, comme dans une photo. 1939, le début de la guerre. Mais, cette
présence « physique » est-elle vraiment importante, ou n’est-elle que
du bruit ? Ça dépend. Ça dépend si celui qui l’a touchée est parti à la
guerre, s’il est mort à la guerre. Ce qui compte, c’est aussi, surtout, la date
où la phrase a été prononcée. Est-ce en 1944 et la femme attend des nouvelles
du front ? En 1950 ? En 1990 ? Tout change en fonction de la
date qui n’est pas dite. Ou presque.
Imaginons la légende suivante : Paysanne octogénaire qui parle de son mari
en 1981. Tout devient plus clair. Comment ce qui était déjà clair peut-il
devenir encore plus clair, sans aveugler ? Parce que le
« clair » dont on parle n’est pas le clair de la lumière. La
métaphore induit en erreur. Plus que de clarté, il faudrait parler
d’interconnexion ou de mise dans le monde. De liens.
Son mari est-il encore vivant et donc
est-elle en train de confesser l’inconfessable pour une femme de son âge ?
Est-ce que d’autres l’ont touchée ? Voilà d’autres question qui peuvent
aider à restreindre toujours plus la portée de la phrase. À la rendre
individuelle. Unique.
Non, personne ne l’a plus touchée. Pendant
quarante-deux ans, personne ne l’a touchée. Oui, son mari est encore vivant et
l’écoute en haussant les épaules. Cette paysanne italienne en 1939 était au
début de la quarantaine, comme son mari.
Je pourrais continuer à analyser cette phrase. Comme une photo. Je
pourrais élargir le cercle de la signification jusqu’à le faire exploser. Je ne
le ferai pas, parce que ça fait mal, trop mal et que cette femme était ma
grand-mère.
Mieux vaut revenir à la théorie. Cette phrase,
je la traîne depuis 1981. Elle a imprimé une photo dans mon cerveau. Une photo
au cercle infini. Une photo de famille qui s’est transformée en une photo d’une
portée universelle à cause de sa particularité. Parce qu’il s’agissait de ma
grand-mère.
Est-ce qu’une phrase comme celle-ci peut faire le même effet qu’une
photo ? Oui, de certains points de vue.
Une affirmation… comme une photo ? Non, de certains points de vue.
Sans doute
qu’il faudrait parler des photos avec des photos, si l’on ne veut pas que la
langue prenne toute la place.
18 juillet 2004 Mort et cire. Ces jours-ci, je ramasse tout ce qui a trait aux photos. Même de la merde. Ne voulant pas courir le risque de laisser échapper quelque chose d’important, contrairement à mes habitudes, je ne fais aucune confiance à la première impression. Je me retrouve donc envahi par des tas d’ordures. Des ordures « symboliques », bien sûr, des ordures qui ont la qualité de ne pas puer même si on les laisse traîner longtemps. Dans le tas, j’en ai trouvé qui m’ont fait tous les effets imaginables, mais, jusqu’à ce matin, aucune ne m’avait donné envie de vomir, même les plus ordurières.
Ce matin, j’ai acheté un petit livre de la collection Icons de Taschen qui reproduit les photos des cires anatomiques du musée La specola de Florence. Et là, et là je me suis aperçu que j’avais exagéré. J’étais allé trop loin pour mon estomac. Ce n’est pas seulement mon estomac et ma gorge mais tout mon corps qui se rebellait. Je sentais un vide énorme, fade. Surtout fade. J’avais besoin de sel, d’alcool. N’importe quoi qui pouvait me faire sortir de cette prison de vide.
Ces corps lisses, lucides, luisants, colorés. Ce manque de texture, ce brillant. Cette immobilité, cette excavation sans résidus. Cette ouverture propre des corps. Tout cela sent la mort. C’est la mort. Même les organes génitaux féminins, et dieu sait qu’il n’y rien de plus vivant, même les organes génitaux féminins sont vides-morts.
Ces photos de corps
ouverts sont la mort à l’état pur. Sans violence. L’essence de la mort.
Ce n’est pas un jeu rhétorique, c’est de la scripte-réalité… je dois
arrêter d’écrire et boire un café si je ne veux pas vomir sur mon bureau.